À l’ère du formateur-facilitateur, l’exposé ou le cours magistral n’est plus “tendance” ! À longueur d’articles et de posts sur les réseaux sociaux, on nous invite, parfois on nous somme, d’abandonner cette approche pédagogique surannée. Nous-mêmes, dans ce blog et dans nos formations, nous invitons les formateurs à utiliser cette pédagogie avec parcimonie. Mais nous nous gardons bien de la supprimer ! Quand on a un contenu important à transmettre et que les participants ne connaissent pas ou très mal le sujet, l’exposé est une méthode loin d’être dénuée intérêt. Reste à l’utiliser au mieux. Le but de cet article est de vous proposer deux pistes concrètes pour faire de vos exposés (ou cours magistraux) des temps d’apprentissages réflexifs et interactifs et non pas seulement passifs…
Soigner les consignes avant de démarrer
Écouter efficacement un cours magistral n’est pas donné à tout le monde. Certains apprenants savent mieux le faire que d’autres. Or, trop souvent les formateurs et formatrices se concentrent sur la qualité didactique de leur exposé et très peu sur le processus d’acquisition du message, par les apprenants eux-mêmes.
Plutôt que de soigner nos animations PowerPoint©, il nous est plus utile en tant que formateur de soigner les consignes d’apprentissage à donner à nos apprenants. En voici, 4 principales :
1-Placer ses apprenants dans une « bulle pédagogique »
Avant toute chose, il faut rappeler l’enjeu de l’attention. Avant de démarrer son exposé, rappeler tout simplement l’importance de se concentrer et de se mettre le temps de l’exposé dans une sorte de « bulle pédagogique », où on élimine tous ses distracteurs sensoriels. On peut le faire de façon positive, sans passer pour le père fouettard. Par exemple en introduisant son propos par :
« Je vais démarrer un exposé de 20 minutes. Ce que je vais vous expliquer va vous paraître peut-être un peu complexe ou déstabilisant, c’est pourquoi je vais vous demander toute votre attention… ».
Vous n’êtes pas obligé de leur demander de couper leurs téléphones ou de ne plus répondre à leurs notifications. Un simple cadrage peut être une première étape pour les amener à se concentrer. Insistez sur la durée courte de l’exposé, à la façon de la méthode Pomodoro , cela les amène à mieux supporter l’effort de travail cognitif que vous allez leur demander. Mais comme on va le voir dans les principes suivants, placer les apprenants dans une bulle pédagogique, ce n’est qu’un début.
2-Inviter à prendre des notes
Pour renforcer, la concentration de vos apprenants, la deuxième étape est évidemment de les inviter à prendre des notes.
Et pourtant à l’ère digitale, la prise de note est devenue une pratique rare. Combien de fois, nous avons la question avant même de démarrer une présentation : « Petite question, est-ce que vous remettrez à la fin de votre exposé, la copie du diaporama ? ». La question n’est pas innocente, si l’on répond par l’affirmative, l’apprenant ou l’apprenante pose immédiatement son stylo !
Pire depuis quelques mois, lors de webinaires, nous croisons des intrus sous la forme « d’IA participantes ». Plus besoin d’écouter le cours, on en aura le résumé automatique par l’IA !
Les « apprenants » qui pratiquent ainsi n’ont pas compris grand-chose à l’acte d’apprendre. Apprendre, ce n’est pas accumuler dans un coin de son ordinateur ou de son espace cloud de l’information, c’est intégrer, s’approprier, relier, digérer des informations, pour structurer sa pensée. Et sans prise de notes, sans engagement cognitif, comment faire ?
C’est pourquoi, avant de démarrer un cours magistral, il n’est pas inutile de rappeler quelques fondamentaux, par exemple :
« Je vous invite à prendre des notes pendant mon exposé. Ce n’est pas tant pour que vous gardiez le contenu (je vous rassure, vous aurez la copie du diaporama) mais pour que vous reliez au mieux ce que je vais vous dire, avec vos connaissances antérieures. Pour ce faire, prenez des notes en “double piste”. Divisez votre page en 3 quarts, 1 quart. Sur la partie 3 quarts, notez l’essentiel de ce que je dis et sur la partie 1 quart, ce que cela vous inspire, vous invite à faire, à approfondir »
3-Indiquer l’usage qui devra être fait du contenu
Pour renforcer la concentration, il est important que les apprenants sachent ce qu’ils feront des informations qu’ils vont recueillir lors de votre exposé. Car, l’attention endogène (celle qui vient de leur intérêt à vous écouter) est encore plus importante que l’attention exogène (celle qui vient de votre capacité oratoire ou des magnifiques diaporamas que vous présentez !).
Rappeler au démarrage de l’exposé les épreuves qu’auront à réaliser les apprenants, les invite à se concentrer. Par exemple vous pouvez poursuivre l’introduction de votre exposé par :
« L’exposé que je vais vous faire, vous servira pour répondre au quiz ou aux questions de compréhension que je vous proposerai ensuite… ».
Savoir que mes connaissances seront testées, m’invite à me concentrer. Selon les profils d’apprenants, on joue alors sur l’effet compétition ou sur l’effet « Peur de perdre la face » !
4-Prévenir les biais de confirmation
C’est bien connu aujourd’hui, nous avons tous tendance à chercher dans les propos de nos interlocuteurs, ce qui confirme nos convictions. C’est ce que l’on appelle en psychologie les “biais de confirmation”.
Les apprenants, comme tout individu, sont sujets à ce biais cognitif. Problème : pour apprendre, il faut accepter de désapprendre et donc de lutter contre ce type de biais cognitif.
Là aussi, le rappeler avant de démarrer son exposé peut influencer la posture de vos apprenants à l’égard de votre message. Par exemple :
« Je vais probablement vous exposer de nouvelles façons de voir le sujet que vous connaissez déjà. Cela risque de vous étonner, voire de remettre en cause certaines de vos convictions. Je vous demanderai simplement de suivre l’énoncer de mon propos jusqu’à la fin. Puis, nous prendrons un temps pour en débattre et le discuter… »
Architecturer ses exposés selon le principe d’une valse à 3 temps
Chez C-Campus nous avons élaboré un modèle pour scénariser de façon optimale la progression pédagogique, dit Modèle EDRACT®. Ce modèle s’applique pour des formations pratiques, invitant au passage à l’action (le « A » signifie d’ailleurs « Action »). Dans le temps d’un exposé, le modèle EDRACT® ne peut pas s’appliquer intégralement (difficile de passer à l’action !). Mais on peut reprendre ses 3 premières étapes (EDR) pour dynamiser ses exposés et ainsi architecturer au mieux le déroulé d’un cours magistral :
E pour S’engager
Le premier temps de cette valse pédagogique qu’est un exposé, consiste à engager les apprenants. Par engagement, nous attendons ici, “engagement cognitif” et non pas “engagement motivationnel” (ce que nous avons vu dans la partie précédente liée à l’attention). Il s’agit d’amener l’apprenant à activer ses “prénotions” sur le thème de l’exposé, afin qu’il accueille au mieux les notions nouvelles que vous allez lui apporter.
Pour ce faire, vous pouvez démarrer par un Quiz starter, un jeu du lexique (matching de définitions avec des concepts), un “photolangage” ou encore une Foire aux questions. Bref avant de parler, commençons par faire réfléchir et écouter nos apprenants, pour mieux comprendre leurs besoins !
 Les techniques pédagogiques que nous présentons dans cet article sont regroupées dans notre jeu de cartes La pédagothèque 1. Ce jeu comprend 33 techniques actives et interactives, que vous pouvez utiliser pour redynamiser vos formations et les rendre ainsi plus captivantes. Découvrez-les en cliquant ici et contactez-nous pour les commander : edition@c-campus.fr.
Les techniques pédagogiques que nous présentons dans cet article sont regroupées dans notre jeu de cartes La pédagothèque 1. Ce jeu comprend 33 techniques actives et interactives, que vous pouvez utiliser pour redynamiser vos formations et les rendre ainsi plus captivantes. Découvrez-les en cliquant ici et contactez-nous pour les commander : edition@c-campus.fr.
D pour Découvrir
Ce deuxième temps, est l’étape classique de l’exposé. Le moment où vous apportez les connaissances pour faire découvrir de nouvelles façons de voir ou de faire. Tout l’art va consister à être à la fois pertinent (c’est-à-dire s’adapter en fonction de ce que vous ont dit vos apprenants lors de l’étape « S’engager ») et structurant (c’est-à-dire leur permettre d’organiser et relier au mieux les nouvelles connaissances).
Pour ce faire, on vous invite à soigner la présentation de vos contenus avec des techniques telles que le “jeu du concept”, le “portrait de l’outil”, le “diaporama 6’90’’, etc.
R pour Réfléchir
Ce troisième temps passe souvent à la trappe et c’est pourtant le temps essentiel, aussi bien d’un point de vue motivationnel (cf. “3) Indiquer l’usage qui devra être fait du contenu”) que d’un point de vue cognitif.
De nombreuses études ont montré que la mémorisation à long terme dépend de la capacité des apprenants à pouvoir se tester, résumer, reprendre plusieurs fois ce que l’on a appris. (cf. article de synthèse de Lévesque-Dion – ou la présentation détaillée de l’étude de Roediger et Karpicke)
Cette étape de réflexion peut être mise en oeuvre à nouveau par quelques techniques simples à utiliser en fin d’exposé. Par exemple en organisant une séance « Pépites et questions », en faisant faire une « Carte Mentale » sur ce qui a été présentée, en proposant un exercice “d’analyse critique” ou encore en posant une ou plusieurs “questions de synthèses”.
Loin de vous avoir invité à multiplier vos exposés dans vos formations, nous espérons que cet article vous permettra de les utiliser au mieux dans vos formations et d’une certaine façon de les réhabiliter à vos yeux de pédagogues. Car ne l’oublions pas, à l’ère de “l’IAisation” des métiers tertiaires et quaternaires, l’apprentissage professionnel passe souvent par l’acquisition et la mémorisation de connaissances de plus en plus sophistiquées. Des exposés bien réalisés restent par conséquent une approche pédagogique plus que jamais pertinente !
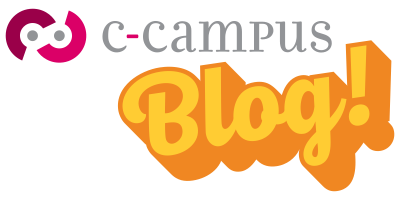

 Vous souhaitez vous former à la conception de formations engageantes et captivantes ? Inscrivez-vous à notre formation “Concevoir une formation”. Vous y découvrirez le modèle EDRACT et la pédagothèque C-Campus. Contactez-nous :
Vous souhaitez vous former à la conception de formations engageantes et captivantes ? Inscrivez-vous à notre formation “Concevoir une formation”. Vous y découvrirez le modèle EDRACT et la pédagothèque C-Campus. Contactez-nous : 
