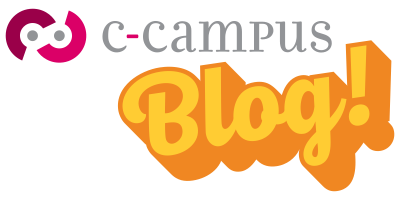Les pouvoirs publics ont du mal avec la pédagogie des contrats d’apprentissage. Pour preuves : avec la loi du 5 septembre 2018, ils ouvrent enfin l’AFEST à la formation professionnelle continue, mais ils l’excluent encore pour l’apprentissage. Avec la loi de finance du 14 février 2025, ils réduisent les « NPEC » (niveaux de prise en charge) de la formation à distance. Pourquoi ces réticences autour de modalités pédagogiques, qui pourtant ont fait leur preuve ? Et comment libérer les contrats d’apprentissage de contraintes pédagogiques, qui n’ont plus lieu d’être ?
Cet article fait partie d’une série de 5 articles que nous publions cet sur le blog de C-Campus. Ils ont été publié préalablement par notre partenaire, l’agence d’information : News Tank rh management.
 News Tank rh management est depuis 2012 l’agence d’information de référence pour les décideurs. Indépendante, elle est spécialisée dans l’actualité des relations sociales, de la formation professionnelle, du learning, des compétences, du talent management et des technologies au service des RH. Cliquez-ici pour un abonnement gratuit d’un mois.
News Tank rh management est depuis 2012 l’agence d’information de référence pour les décideurs. Indépendante, elle est spécialisée dans l’actualité des relations sociales, de la formation professionnelle, du learning, des compétences, du talent management et des technologies au service des RH. Cliquez-ici pour un abonnement gratuit d’un mois.
Les décideurs victimes de la doxa pédagogique
Les pouvoirs publics, et plus largement, la plupart des décideurs dans le domaine de la formation sont victimes de ce que l’on pourrait appeler, avec Pierre Bourdieu, la « doxa pédagogique », c’est-à-dire de la pensée dominante en formation, du sens commun accepté par tous et allant de soi sur ce qu’est une « bonne » formation.
Cette représentation de la formation efficace, jamais clairement énoncée, mais toujours présente dans les discours tenus et les décisions prises est fortement marquée par « l’empreinte scolaire ». Ceux qui font aujourd’hui la doctrine sur la formation, croient encore que former, c’est « faire classe », c’est transmettre un savoir ou un savoir-faire. Et que la bonne formation, c’est la formation classique avec son unité de lieu (un espace délimité en dehors du travail), son unité d’action (un ensemble de participants poursuivant tous les mêmes objectifs pédagogiques) et de temps (et le faisant en même temps, à pas cadencés !).
Le digital learning, le metaverse ou même l’IA, pour l’instant, ne changent rien à cette vision passéiste. Ces nouvelles technologies sont au service d’une approche scolaro-centrée de la formation : ils permettent seulement d’optimiser à la marge les processus de formation et ne changent pas grand-chose aux processus d’apprentissage.
Comme le dit le Professeur émérite spécialiste de l’apprenance, Philippe Carré, cette représentation classique de la formation, c’est « l’erreur pédagogique fondamentale[1] » que l’on peut traduire à travers trois idées fausses, lourdes de conséquences :
- On ne forme jamais une personne, c’est la personne qui apprend !
- L’adulte en formation, n’est pas un élève qui a grandi : ses connaissances antérieures, ses préconceptions de ce qu’est l’apprentissage et ses motivations déterminent grandement son engagement et ses préférences, en matière de modalités d’apprentissage.
- Il n’existe pas de « parfaite méthode » ou de « one best way pédagogique » en formation des adultes. L’efficacité pédagogique est plurielle (combinaison de « constantes de l’apprentissage », de « variables pédagogiques » et de « variables socio-organisationnelles ») et contingente (toujours dépendante du contexte de formation (profil des apprenants, support du management ou du financeur, Etc.).
Croire que la formation « c’est l’école des grands », induit des prises de position qui vont à l’encontre de ce que devrait être la formation aujourd’hui. C’est malheureusement ce que fait le Législateur, quand il exclue l’AFEST de l’apprentissage et quand il cherche à pénaliser la formation à distance. Loin de s’ouvrir à la logique de « l’apprenance » et de placer l’apprenant au cœur des dispositifs d’apprentissage, il plaque le bon vieux modèle scolaire.
 Vous ne connaissez pas C-Campus ou vous voulez mieux nous connaître ? Consultez notre site complet et aussi nos offres de formation inter / intra ou encore nos offres de formation individualisée pour vous former pendant l’été !
Vous ne connaissez pas C-Campus ou vous voulez mieux nous connaître ? Consultez notre site complet et aussi nos offres de formation inter / intra ou encore nos offres de formation individualisée pour vous former pendant l’été !
L’alternance pédagogique, l’impensé de la loi du 5 septembre 2018
Cette représentation passéiste de la formation, se traduit plus globalement dans des principes implicites qui sont au fondement de la pédagogie de l’alternance, telle qu’elle a été pensée, ou pour être plus précis « impensée », à travers la loi du 5 septembre 2018.
Pour les résumer rapidement :
- La responsabilité de la réussite à la formation porte quasi exclusivement sur le CFA. Il revient au centre de formation de mettre en place la formation la plus efficace possible, en respectant les 32 critères de Qualiopi et en s’engageant à respecter la prestation vendue (contrôle du service fait). En cas d’abandon, c’est le CFA qui est pénalisé par le financeur, pas l’apprenant ni l’employeur.
- Les entreprises sont incitées (avec force monnaies sonnantes et trébuchantes) à embaucher des apprentis mais n’ont pas en contrepartie, d’exigences de formation de la part de l’État. Et rares sont les OPCO qui exigent d’ailleurs une formation ou une habilitation / qualification pédagogique des tuteurs (seules des règles de sélection du Maître d’apprentissage sont contrôlées).
- Conséquence : on est dans une logique d’alternance « juxtaposée » (en CFA, on apprend les fondamentaux du métier versus en entreprise on pratique, de façon plus ou moins bien accompagné) et non pas « intégrée » (ce que l’on apprend en formation est approfondi en entreprise et vice et versa).
La France peut être fière de son million d’apprentis, mais on est bien loin du modèle dual allemand. En francisant le modèle allemand de l’apprentissage, le Législateur l’a détourné pédagogiquement. Le lien formation-travail n’a pas été pensé et stimulé. On a reproduit le schéma scolaire, d’où les parts de marché prises par les écoles de l’enseignement supérieur privé, dans le champ de l’alternance. L’effet quantitatif du million d’apprentis ne s’est pas traduit par une effervescence en termes d’innovation pédagogique : point de logique d’apprenance, d’alternance intégrée, ou de personnalisation des parcours.
3 pistes pour sortir de l’impasse gestionnaire et libérer la pédagogie de l’apprentissage de ses contraintes
Face aux abus de certains opérateurs et surtout aux conséquences de la crise budgétaire, Gouvernement et Législateur essaient de résoudre le problème en urgence. Guidés à la fois par une logique passéiste de ce qu’est une « bonne » formation en alternance et une approche gestionnaire (faire autant avec moins !), ils préconisent des solutions-rustines, là où il faudrait repenser totalement le modèle d’apprentissage.
Sans pouvoir, dans l’espace de cet article, présenter complétement ce que pourrait être un modèle en alternance alternatif à celui de la loi du 5 septembre 2018, nous souhaiterions indiquer trois pistes à investiguer pour sortir de la double impasse scolaro-centrée et gestionnaire :
Piste #1 : éviter de rajouter des contraintes pédagogiques à l’apprentissage
Puisqu’il n’existe pas de « one best way pédagogique », évitons de fixer un cadre contraignant en matière pédagogique pour l’apprentissage.
- Ouvrons enfin l’apprentissage à l’AFEST, car l’AFEST est une modalité pédagogique qui a toute sa place dans une formation en alternance, notamment parce qu’elle peut mobiliser davantage l’entreprise dans l’apprentissage (cf. piste #3)
- Évitons les mesquineries et cessons la réduction de 20% des NPEC pour les formations 100% à distance, car formation à distance + un tutorat bien structuré, c’est un combo gagnant dans bien des cas de formations en apprentissage.
- Et enfin arrêtons les contrôles qui se multiplient dans le domaine de la pédagogie (Qualiopi, D2OF, et aujourd’hui Caisse des Dépôts) et qui ne font qu’augmenter les coûts des formations, sans pour autant empêcher les organismes de formation malveillants de proliférer. Pire, ils renforcent les pratiques scolaro-centrés, car les auditeurs/contrôleurs sont loin d’être des experts de la pédagogie des adultes. Ils n’ont le plus souvent comme expertise dans le domaine de la formation, que leur expérience d’élève puis d’étudiant.
Et pourtant, cela n’empêche pas ces auditeurs/contrôleurs de s’autoriser à demander, parfois exiger, et dans tous les cas chercher à évaluer, la qualité des objectifs et scénarios pédagogiques, des quiz d’évaluation, des dispositifs d’accompagnement mis en place, etc. Soyons sérieux ! Est-ce qu’on imaginerait dans le transport aérien, un auditeur n’ayant jamais volé, faire passer une Qualification de Type (QT) à un commandant de bord d’Airbus ou de Boeing ? C’est pourtant ce qui se passe quand un organisme de formation répond à des questions sur la pédagogie, à la plupart des autorités de contrôles et des auditeurs de la formation. Laissons chacun faire son métier : le pédagogue, faire de la pédagogie et l’auditeur auditer les seuls processus de gestion et les résultats obtenus (cf. piste #2).
Piste #2 : se focaliser sur l’évaluation de la vraie valeur ajoutée d’un CFA
La vraie valeur ajoutée d’un CFA, c’est sa capacité à développer les compétences de ses apprentis à moindre coût. Mesurer cette valeur ajoutée est assez facile. Il suffit de comparer les compétences maîtrisées à la sortie, au regard des compétences à l’entrée et de rapporter le gain en compétences aux investissements consentis (les coûts de formation).
Mais cela suppose de changer de « métrique » : plus besoin d’évaluer le nombre d’heures de formation ou la qualité d’une formation, il suffit d’évaluer les résultats de la formation en termes d’accroissement du niveau de compétences. Et ceci est d’autant plus facile, qu’en apprentissage toute formation se termine par une certification.
En changeant de métrique, plus besoin de faire des contrôles de service faits compliqués (et même de contrôle Qualiopi !). N’importe quelle IA est capable de traiter ce type de données. Reste à avoir des données d’entrées et de sorties, de qualité. Et pour ce faire, il faudrait repenser le système de certification imaginé en 2002 et séparer les fonctions d’opérateurs de certification et celles d’opérateur de formation. Là aussi, « Chacun son métier et les vaches seront bien gardés… Cela ne se fera probablement pas en un jour, mais c’est inéluctable si on veut réellement assainir le marché de la formation.
Piste #3 : conditionner les aides aux entreprises et / ou valoriser les entreprises exemplaires
Plutôt que de retoiletter un système dispendieux, exigeons des entreprises qu’elles s’investissent réellement dans l’apprentissage. Ce n’est pas en leur faisant payer un « Reste À Charge » (RAC) symbolique de 750 euros ou en étant moins généreux concernant les aides à l’embauche de certains publics d’apprentis, qu’on va à la fois résoudre le problème du financement de l’apprentissage et en améliorer son efficacité.
Dans le domaine de l’apprentissage, il faut repartir de zéro. Oublier l’objectif quantitatif du million d’apprentis et se concentrer sur l’objectif de qualité : une « fabrique des compétences accélérée » (cf. notre article précédent) grâce à une pédagogie profitant pleinement du principe de l’alternance.
Les entreprises en manque de compétences ne s’y sont pas trompées. Elles ne sont pas lancées dans la chasse à la prime. Elles ont investi dans la formation de leur tuteurs, elles ont bâti des parcours de formation terrain (et souvent d’AFEST, sans chercher aucun co-financement). Elles ont organisé des formations complémentaires pour aider leurs apprentis à développer des compétences qui leurs sont propres. Elles ont mobilisé les managers et les collègues des apprentis, pour transmettre les savoir-faire métiers mais aussi et surtout ses valeurs et son éthique.
Aujourd’hui, il faut aller plus loin et inciter et valoriser les entreprises qui font comme ces leaders de l’apprentissage. Pourquoi alors ne pas conditionner les primes à l’apprentissage à certaines bonnes pratiques (formation des tuteurs, mise en place de parcours de formation terrain…) et/ou valoriser par un label « Entreprise apprenante », les entreprises qui s’engagent à mettre en œuvre ces bonnes pratiques. On réduirait les effets d’aubaines et on accompagnerait la montée en compétence, et donc en gamme, des entreprises françaises !
[1] Cf. Le rapport réalisé par Philippe Carré pour le compte de la Fédération des acteurs de la compétence : « L’efficacité pédagogique en formation pour adultes » est sorti en librairie aux éditions Dunod en juin dernier. Cet article repose sur un grand nombre de conclusions de ce rapport.