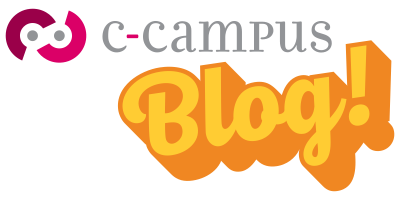Le décret n°2025-500 du 6 juin 2025 renforce les liens entre formation et certification. Ces liaisons, de plus en plus étroites depuis la création du RNCP en janvier 2022, sont potentiellement sources de dysfonctionnements majeurs pour le système de formation français : conflits d’intérêts, compétences non contrôlées des organismes certificateurs et éthique professionnelle des formateurs et formatrices mise à mal.
Plutôt que de complexifier les relations d’interdépendances entre organismes de formation et organismes certificateurs, il est grand temps de repenser nos systèmes de formation et de certification. Distinguer clairement les statuts de ces deux types d’organismes, professionnaliser le métier d’évaluateur des compétences et redéfinir les missions des organismes de formation et les moyens de les évaluer, sont trois priorités que pourraient porter une prochaine réforme de la formation… et de la certification.
Cet article fait partie d’une série de 5 articles que nous publions cet été sur le blog de C-Campus. Ils ont été publié préalablement par notre partenaire, l’agence d’information : News Tank rh management.
 News Tank rh management est depuis 2012 l’agence d’information de référence pour les décideurs. Indépendante, elle est spécialisée dans l’actualité des relations sociales, de la formation professionnelle, du learning, des compétences, du talent management et des technologies au service des RH. Cliquez-ici pour un abonnement gratuit d’un mois.
News Tank rh management est depuis 2012 l’agence d’information de référence pour les décideurs. Indépendante, elle est spécialisée dans l’actualité des relations sociales, de la formation professionnelle, du learning, des compétences, du talent management et des technologies au service des RH. Cliquez-ici pour un abonnement gratuit d’un mois.
3 sources majeures de dysfonctionnements
En autorisant et même en favorisant la confusion entre missions de formation et de certification au sein d’un même organisme, le Législateur et les gouvernements successifs ont créé trois sources majeures de dysfonctionnements dans le système de formation professionnelle français.
Un évident conflit d’intérêts commerciaux
La première source de dysfonctionnement réside dans le conflit d’intérêt entre la mission de formation et la mission de certification. Quand, au sein d’un même organisme commercial, on doit à la fois former et certifier, il y a un risque évident d’être « moins regardant » sur les exigences en matière d’évaluation en vue de certifier les personnes que l’on a formées.
Évidemment, aucun organisme de formation ne l’avouera. Et tous argumenteront que leur déontologie les empêche de tomber dans le piège du laxisme. Mais reconnaissons que tout le système les y pousse.
- Il y a d’abord les contraintes des financeurs et de Qualiopi, qui de façon plus ou moins directe, les invite à avoir de bons taux en matière de complétude du parcours et de taux de réussite aux épreuves de certification.
- Il y a ensuite les entreprises et les apprenants eux-mêmes, qui ne comprennent pas qu’ayant payé pour passer la certification, ils ne l’obtiennent pas. Cela devient un sujet de réclamation de plus en plus important pour les organismes de formation.
- Il y a enfin les contraintes de productivité des organismes de formation eux-mêmes. Plus vite l’apprenant obtient sa certification, plus vite ils sont payés (notamment par les financeurs publics). Quand on connaît le problème récurrent de BFR (Besoin en Fonds de Roulement) des opérateurs de formation, il n’y a aucun doute que ce critère est loin d’être négligeable !
Conséquence : les organismes de formation qui font eux-mêmes passer les épreuves de certification, ont tendance à tout faire pour aller vers un taux de réussite élevé. Lorsque le système est construit en cascade (un organisme est le certificateur d’autres organismes de formation) la relation commerciale entre les deux types d’opérateurs vient trop souvent perturber la mission d’évaluation du certificateur. Mettre en évidence ces conflits d’intérêt, ce n’est pas jeter la pierre aux organismes de formation, c’est seulement mettre au jour les principes au fondement du double système formation / certification : pour voir sa formation co-financée (CPF ou apprentissage), l’organisme de formation doit exercer une mission de certification ou tisser des relations commerciales avec un organisme certificateur, lui-même le plus souvent opérant sur un marché lucratif et concurrentiel.
Des compétences radicalement différentes
La deuxième source de dysfonctionnement provient du savoir-faire des personnes qui ont la charge d’évaluer les compétences au sein d’un organisme de formation et de celles qui l’exercent chez un certificateur.
Hormis pour les langues et certaines certifications en informatique, historiquement la mission d’évaluation des compétences est venue se rajouter à celle de formation, au sein des organismes de formation. Les formateurs sont devenus ainsi des évaluateurs. Mais les compétences d’évaluation et de formation sont fondamentalement différentes. Surtout quand il s’agit d’évaluer des compétences, c’est-à-dire la mise en œuvre en situation professionnelle d’un savoir-faire métier.
Pour évaluer une compétence, il faut être capable d’observer en situation et/ou de questionner à l’aide d’une approche de type « analyse réflexive ». Or combien de formateurs ont été formés à ces techniques ? Ce n’est pas parce que je sais transmettre une connaissance ou savoir-faire, que je sais évaluer les compétences développées !
 Vous ne connaissez pas C-Campus ou vous voulez mieux nous connaître ? Consultez notre site complet et aussi nos offres de formation inter / intra ou encore nos offres de formation individualisée pour vous former pendant l’été !
Vous ne connaissez pas C-Campus ou vous voulez mieux nous connaître ? Consultez notre site complet et aussi nos offres de formation inter / intra ou encore nos offres de formation individualisée pour vous former pendant l’été !
Une posture paradoxale
Dans les années 1970 / 1990, l’éthique du formateur s’est construite sur la base d’une distinction assumée entre rôle de formateur et rôle d’évaluateur. En opposition au modèle de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur, le monde de la formation, dans la continuité des valeurs du mouvement de mai 1968, s’interdisait d’évaluer. Évaluer, c’était porter un jugement, c’était exercer un pouvoir sur autrui.
Aujourd’hui, cette antienne est bien loin. Bien que les personnes faisant passer les examens finaux ne sont pas les personnes formatrices, il est évident qu’il y a de plus en plus une confusion des genres au sein d’un organisme à la fois formateur et certificateur. Le formateur doit alors adopter une posture paradoxale : aider de façon bienveillante l’apprenant et en même temps l’évaluer comme dans le cadre d’un contrôle continu ou dans le cas du devoir d’alerte, lors d’un risque de décrochage.
Pris dans l’injonction paradoxale d’être à la fois formateurs et évaluateurs, de plus en plus nombreux sont ceux et celles qui s’interrogent sur leur mission et qui ont de plus en plus de mal à vivre dans leur quotidien, auprès de leurs apprenants, ces attitudes paradoxales que le système exige d’eux.
Vers une séparation stricte des missions
Aujourd’hui, les pouvoirs publics ont pris conscience que le système de formation né de la réforme de 2018 a du mal à répondre aux attentes. Face à ce constat réaliste et salvateur (il était temps !), la logique qui semble présider est de colmater les brèches. On s’attaque aux fraudes, aux surcoûts, aux problèmes évidents de qualité par petites touches : relation certificateur / organisme de formation, Qualiopi +, etc. Mais ce n’est pas en empilant les contraintes que l’on remettra le système d’aplomb ! Une approche plus radicale est nécessaire. Elle passe notamment par une distinction claire entre les missions de formation et de certification.
Créer des statuts différents et incompatibles
A l’instar de la séparation du conseil et de l’audit à la suite de la crise des subprimes de 2008 dans la finance, il paraît nécessaire d’appliquer la même logique dans le monde de la formation. Un organisme de formation ne devrait plus pouvoir à la fois former et certifier. Et lorsqu’il prépare à la certification, l’organisme de formation ne devrait pas être lié par des liens commerciaux négociés de gré à gré.
Clarifier la mission d’organisme de formation et mieux l’évaluer
Mettre en place ce principe de séparation des opérateurs permettrait de s’attaquer au fond du problème.
- La première conséquence serait de clarifier la mission d’organisme de formation. Si sa raison d’être n’est plus que de développer les compétences, l’opérateur de formation n’aura plus la charge de l’insertion professionnelle (qui lui incombe de plus en plus), ni de la pertinence de la certification (celle-ci n’incomberait plus qu’au certificateur).
- La seconde permettrait de repenser l’évaluation des organismes de formation. Fini les taux d’insertion professionnelle donc, mais aussi exit la preuve de la qualité des processus (Qualiopi) ou du service fait (contrôles D2OF et depuis peu EDOF). Si le certificateur est indépendant et donc irréprochable, le taux d’obtention de la certification redevient un critère fiable et suffisant, pour évaluer la mission des organismes de formation.
Mais il ne doit pas être le seul critère d’évaluation. Il est à combiner avec la prise en compte du niveau d’entrée dans le parcours de formation de l’apprenant, pour éviter tout biais de sélection des apprenants. Concrètement, la valeur ajoutée de l’organisme de formation dans un tel système pourrait être évaluée à l’aune de la montée en compétences des apprenants dont il a la charge, se calculant sur la base de l’écart entre niveau de compétence à la fin de formation (évaluation finale au regard du référentiel de certification) rapporté au niveau de compétence à l’entrée (positionnement en amont).
Définir un statut d’organisme de certification et professionnaliser le métier d’évaluateur des compétences
Si au fil du temps, les réglementation successives ont permis l’émergence d’un statut d’organisme de formation, autour du NDA (Numéro de Déclaration d’Activité) et du BPF (Bilan Pédagogique et Financier) notamment, il n’en est pas de même pour les organismes certificateurs. Ministères, Branches professionnelles, organismes consulaires, opérateurs privés peuvent prétendre à devenir organisme certificateur. Socialement et juridiquement, il n’existe pas de statut au contour précis d’organisme certificateur. Le décret du 6 juin 2025 ébauche quelques règles de fonctionnement, mais on ne peut pas parler de création d’un statut.
Une séparation claire entre organisme certificateur et organisme de formation serait un premier pas pour faire émerger ce statut d’O.C. qui pourrait s’articuler autour de quelques principes tels que :
- Indépendance juridique et financière de l’O.C : l’organisme certificateur et ses dirigeants ne pourraient être liés à aucun organisme de formation et/ou financeur de formation,
- La mission d’OC pourrait elle-même être contrôlée par des auditeurs indépendants, eux-mêmes respectant les règles du métier (donc assujettis à l’accréditation COFRAC)
- Les O.C. ne pourraient plus employer que des évaluateurs de compétences, eux-mêmes formés et habilités au métier spécifique d’évaluation de compétences. Ce qui garantirait une unité de traitement aux apprenants passant les certifications et élèverait le niveau de qualité des évaluations (élimination des quiz et autres exercices à trous, au profit des mises en situation observées et de l’analyse réflexive).
Reconcentrer les professionnels de la formation sur leur métier de développeur de compétences
N’ayant plus à intervenir à deux niveaux (formation et évaluation), les professionnels de formation retrouveraient leur mission première : faire progresser leurs apprenants en vue de réussir leur certification. Le temps de formation serait moins pollué par des contrôles continus ou des suivis administratifs de stagiaires. Toute l’énergie des formateurs et formatrices serait focalisée sur la transmission des connaissances et l’accompagnement. Leurs feedbacks pédagogiques ne seraient plus entachés de relation d’évaluation et de contrôle.
Reconnaissons que de telles évolutions refonderait notre système de formation et de certification. Il ne s’agirait pas d’une « réformette » de plus. C’est toute l’économie du système de formation qui pourrait en être impactée. Elle permettrait de se reposer la question de la réelle valeur ajoutée d’un organisme de formation. Et par voie de conséquence des économies réelles et sérieuses qui pourraient être faites, dans le domaine de l’investissement en compétences de la Nation.