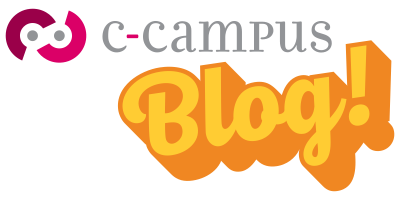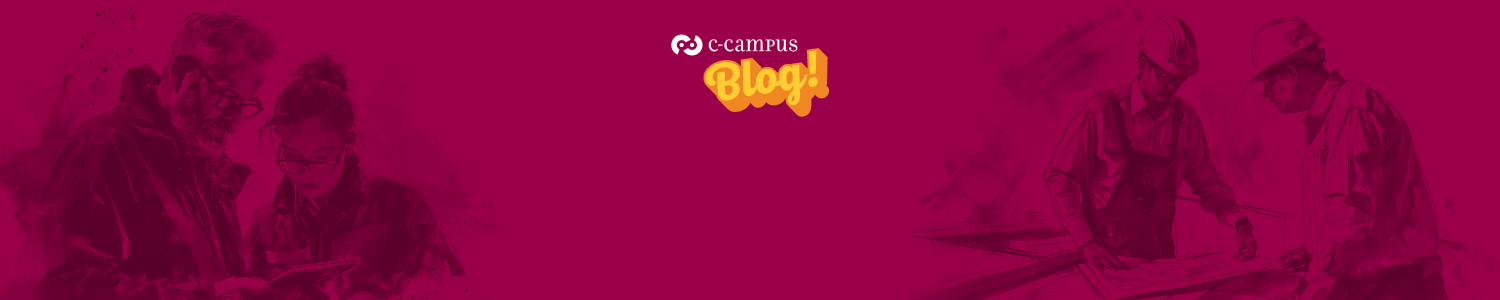Depuis 2016, C-Campus forme et certifie des référents AFEST dans tous les secteurs d’activité. À l’ADAPEI 69, association qui accompagne 60 établissements œuvrant dans le domaine de l’accompagnement de personnes en situation de handicap, l’AFEST s’est imposée comme un levier structurant pour développer les compétences et faire évoluer les pratiques.
Retour d’expériences avec Isabelle Beltra et Chloé Bourdin, toutes deux référentes AFEST formées par C-Campus
Q : Pouvez-vous présenter votre structure et ce qui vous a amenées toutes les deux vers l’AFEST ?
 Chloé Bourdin : L’ADAPEI 69 est une association parentale. Nous accompagnons plus de 2 500 personnes, dont plus de 700 travailleurs en ESAT. Toutes en situation de handicap intellectuel plus ou moins sévère, avec plus ou moins de conséquences sur leur autonomie au quotidien. Nous avons tout de suite été séduites par l’AFEST pour différentes raisons, notamment parce que nous sommes dans une réflexion globale sur la compétence des salariés avec ou sans particularité. Par ailleurs, très tôt, nous avons constaté qu’il manquait des dispositifs adaptés à notre public. Nous avons donc créé un pôle formation interne, pour concevoir nos propres parcours. L’AFEST a donc été la continuité de tout ce processus.
Chloé Bourdin : L’ADAPEI 69 est une association parentale. Nous accompagnons plus de 2 500 personnes, dont plus de 700 travailleurs en ESAT. Toutes en situation de handicap intellectuel plus ou moins sévère, avec plus ou moins de conséquences sur leur autonomie au quotidien. Nous avons tout de suite été séduites par l’AFEST pour différentes raisons, notamment parce que nous sommes dans une réflexion globale sur la compétence des salariés avec ou sans particularité. Par ailleurs, très tôt, nous avons constaté qu’il manquait des dispositifs adaptés à notre public. Nous avons donc créé un pôle formation interne, pour concevoir nos propres parcours. L’AFEST a donc été la continuité de tout ce processus.
L’AFEST s’est imposée comme une évidence. Elle permettait d’ancrer les apprentissages dans le réel, directement sur le poste de travail, et de s’adapter à chaque profil.
Q : pouvez-vous nous parler des AFEST que vous avez mises en œuvre ?
 Isabelle Beltra : Nous avons commencé par travailler sur une AFEST collective qui n’est pas encore terminée, dans le domaine des Espaces Verts.
Isabelle Beltra : Nous avons commencé par travailler sur une AFEST collective qui n’est pas encore terminée, dans le domaine des Espaces Verts.
Ce premier projet a été particulièrement complexe et aujourd’hui les parcours ne sont toujours pas terminés. L’étape d’ingénierie et de communication est allée relativement vite mais l’étape de déploiement a été beaucoup plus longue. J’attribue cela à plusieurs choses : d’abord nous n’avions pas voulu mettre de durée. Ensuite nous avions choisi un bloc de compétences très large et pour terminer, il n’a pas été simple d’assurer un suivi régulier du projet en tant que référent auprès des formateurs terrain.
Et puis, il y a eu la contrainte de la saisonnalité : « On ne sème pas en hiver »… Certaines activités ont dû être reportées, ce qui nous a obligés à adapter le rythme et à repenser la planification.
Nous avons ensuite travaillé sur 2 projets dans 2 établissements différents : une AFEST individuelle dans le domaine de la restauration, plus précisément sur la préparation des plats témoins, et une AFEST également dans le domaine de la restauration, mais sur de la mise en vitrine en restauration collective et préparation des tables.
Nous avons appris à segmenter les activités en micro-tâches, pour sécuriser la progression et rendre les réussites visibles.
On s’est rendu compte qu’il valait mieux commencer petit, avec un bloc de compétences précis, puis d’élargir progressivement.
Fort de ces expériences, un nouveau projet vient de démarrer avec une entreprise adaptée dans le domaine de la logistique.
Q : comment s’est passée la mise en œuvre de la réflexivité auprès des acteurs ?
Nous avons utilisé les temps de débrief de fin de semaine que faisait déjà les équipes, pour réaliser les temps réflexifs. La verbalisation est parfois compliquée.
C’est un point d’échanges important que nous avons eu entre référents avec une question : comment évaluer la capacité réflexive des personnes lors du positionnement ? Sur les 2 AFEST individuelles, il y a une personne qui n’a pas réussi à avoir cette prise de hauteur et surtout à la verbaliser.
Nous avons un outil à créer par rapport à la particularité du public que nous accompagnons, avec un système de picto adapté aux émotions et au vécu. Ce devra être très individualisé en fonction des particularités de la personne accompagnée. La pertinence d’une AFEST collective pour certaines personnes se pose donc vraiment.
Q : ….et pour la mise en œuvre des mises en situation ?
Le plus difficile pour les personnes accompagnées a été d’accepter le droit à l’erreur, tant elles sont très investies dans leur travail. Se tromper les insécurise. Il a fallu créer un climat de confiance via les formateurs terrain, pour leur montrer que l’erreur fait partie intégrante du processus d’apprentissage. Aujourd’hui ils posent même la question « on est en AFEST là ? on peut se tromper ? ».
Q : vous avez évoqué la posture des formateurs. Comment les avez-vous formés ?
Il y a eu 2 actions : une formation “Accompagnateur AFEST”, animée par C-Campus et une journée de formation que nous avons créé sur nos outils et la posture a adopter.
Ce qui nous a aidé dans cet accompagnement, c’est une vidéo qu’on a faite de la formatrice et de la personne accompagnée sur un temps de mise en situation. Cela a permis aux 2 de prendre du recul sur leur posture, afin de se réajuster.
Chloé BOURDIN est notre 1.000 référente AFEST certifiée (ex aequo) “AAFEST” – Certification RS5525 de France Compétences “Accompagnement des apprentissages et de la formation en situation de travail”. Avec sa collègue Isabelle, elles démontrent que les principes pédagogiques AFEST s’adaptent à tous les milieux et publics. Ce constat, nous l’avons aussi partagé avec d’autres intervenants spécialistes des institutions suivantes : DGEFP – ANACT – OPCO – France Travail – France Compétences, etc., lors de la Master Class Centre Inffo du 25 septembre dernier. Si vous vous posez encore des questions en tant que futur référent(e) AFEST : formation@c-campus.fr
Q : vous parlez d’outils. Quels sont-ils ?
Nous avons mis en place un “Protocole Individuel de Formation” très détaillé, un livret de suivi qui formalise les temps de formation, et des guides sur le droit à l’erreur, l’écoute active, le questionnement, l’entretien d’explicitation…On a même créé un logo pour créer une identité propre à ce type de projet d’AFEST.
Avec le recul on aurait dû rédiger des “Fiches d’Activité Pédagogique” car on avait un scénario mais insuffisamment détaillé pour guider nos apprenants. On a encore du travail à faire sur le sujet.
Q : quels bénéfices avez-vous identifiés ?
Déjà pour les formateurs : ce sont des experts avant tout et ils se sont sentis valorisés, reconnus et surtout écoutés, notamment dans la phase d’ingénierie. Au départ, certains étaient réfractaires mais ils ont vite adhéré au projet. Ils se sont eux-mêmes rendu compte de leurs propres compétences !
Ensuite, pour les apprenants : une vraie fierté de montrer leur métier, de valoriser ce qu’ils font et une prise de conscience que ce qu’ils apprennent, ils vont pouvoir l’utiliser ailleurs. Il y a une vraie émulsion autour de l’AFEST.
L’AFEST a aussi transformé le regard des encadrants. Directeurs et chefs de production ont pu « sortir la tête du guidon » pour redécouvrir le travail réel, les gestes, les contraintes et les réussites du quotidien. Cela a permis de prendre conscience de pratiques obsolètes ou inadaptées. Cela a ouvert un dialogue très riche entre les métiers.
L’AFEST s’est véritablement installée dans l’institution. Les moniteurs non impliqués au départ se sont mis à s’y intéresser, à poser des questions, à vouloir s’y essayer. Il y eu une vraie synergie autour de l’AFEST. Aujourd’hui, l’AFEST fait partie de notre culture d’entreprise.
Q : au-delà de l’acquisition des compétences visées par l’AFEST, avez-vous constaté d’autres effets chez les personnes accompagnées ?
Oui. Complètement. Les travailleurs ont acquis une meilleure compréhension de leur environnement professionnel. Ils perçoivent mieux la chaîne de valeur et le rôle de chacun. Cette vision globale des processus change leur rapport au travail. Ils ne sont plus dans la simple application d’une consigne.
Ils ont aussi gagné en confiance : là où certains n’osaient pas parler d’une difficulté, ils alertent désormais spontanément. Ils se sentent légitimes, acteurs et responsables.
Enfin, la reconnaissance de leurs compétences nourrit la fierté et l’envie de transmettre. Certains partagent désormais leurs acquis avec leurs collègues — l’AFEST a fait émerger des “passeurs de savoirs”.
Q : quels conseils donneriez-vous aux organisations qui souhaitent se lancer dans l’AFEST ?
D’abord, commencer modestement, avec un périmètre bien défini. Et accepter d’expérimenter, de tâtonner, d’ajuster, bref…d’apprendre ! Et surtout, impliquer tous les acteurs dès le départ : direction, encadrants, formateurs, accompagnants, RH. L’AFEST est un projet collectif. C’est en s’appuyant sur l’intelligence de tous, qu’on crée la dynamique.
En conclusion
À l’ADAPEI 69, l’AFEST a permis de reconnaître les savoir-faire existants, de renforcer la confiance des travailleurs et de rapprocher les acteurs d’horizons différents. Ce projet, mené avec l’appui méthodologique de C-Campus et ses outils, montre qu’une démarche AFEST bien structurée, bénéficie à tous les niveaux de l’organisation et peut transformer durablement sa culture d’apprentissage.